





 |
  |
|
 |
  |
|
| Printable version (PDF) | ||
1.1 Développement
Après avoir rappelé la définition du concept de développement adoptée dans le premier Rapport fédéral, ce chapitre présente la dizaine de questions de développement sur laquelle est ciblé ce deuxième Rapport (voir 1.1.1). Chacune de ces questions touche à différents aspects de la vie en société. Chacune permet de concrétiser les notions de capital et de composante économique, sociale et environnementale du développement (voir 1.1.2). Ces dix questions concernent un large éventail de secteurs différents. Elles contiennent chacune certaines opportunités mais aussi certains problèmes de développement.
Pour répondre à de telles questions, il faut disposer d'institutions capables de prendre des décisions relatives à ces opportunités et à ces problèmes (voir 1.1.3). C'est le chapitre 1.2 qui examinera sous quelles conditions ces réponses peuvent éventuellement être "durables". Ce chapitre-ci se limite à rappeler quel est le cadre général du développement d'une société. Il ne traite donc pas encore des finalités et contraintes spécifiques d'un développement durable.
1.1.1 Opportunités et problèmes de développement
Le premier Rapport fédéral sur le développement durable définit le développement d'une société comme suit: "le développement d'une société est la transformation de ses conditions de vie en interaction avec ses possibilités de décision et d'action, notamment politiques"1.
Ce deuxième Rapport reprend cette approche et met l'accent sur:
- le fait que les questions de développement ne concernent pas seulement les pays pauvres mais bien tous les pays y compris ceux dits "développés";
- les possibilités qu'ont les "acteurs" d'orienter le développement d'une société vers des objectifs précis au moyen de leurs décisions et autres actions;
- le besoin de connaissances en général et de sciences en particulier (autant de sciences humaines que de sciences exactes et naturelles), pour mieux définir ces possibilités d'orientation du développement;
- les leviers que peuvent utiliser les "décideurs" en agissant sur les "déterminants" qui exercent une influence sur les objectifs poursuivis;
- la notion de "progrès" qui oriente le développement vers la réalisation de certains "objectifs ultimes", à très long terme;
- la possibilité de tracer la voie vers ces objectifs ultimes en adoptant des "objectifs intermédiaires" à court ou à moyen terme.
Les dix questions de développement traitées dans ce rapport sont énumérées au tableau 1.1 ci-contre. Elles sont généralement considérées soit comme économiques (par exemple: énergie, transports, entreprises), soit comme sociales (par exemple: santé, pauvreté, exclusion), soit comme environnementales (par exemple: diversité biologique, changements climatiques). Elles peuvent en effet être reliées, deux par deux, aux cinq grands thèmes de développement suivants: gestion et production des entreprises (1, 2), lutte contre la pauvreté et l'exclusion (3, 4), gestion et conservation des ressources naturelles (5, 6), énergie et transports (7, 8), santé et pollution de l'air (9, 10). Ce Rapport mettra cependant en évidence le fait que leurs solutions concernent l'ensemble de la vie en société. Il ne les traite donc pas de façon sectorielle ou limitée à la gestion du domaine considéré mais de façon transversale.
La plupart de ces dix questions ne sont pas nouvelles. Bon nombre d'entre elles ont été posées en dehors du cadre des accords de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de Rio. Elles ne sont donc généralement pas abordées dans les publications sur le développement durable. Une originalité de ce Rapport est de montrer leur importance non seulement pour le développement en général, comme au tableau 1.1, mais aussi, en particulier, pour un développement durable (voir 1.3).
Ces dix questions de développement ont été choisies selon différents critères: relever au moins en partie de compétences fédérales, porter sur des secteurs dans lesquels des travaux scientifiques existent et des compétences suffisantes ont pu être acquises au sein de l'équipe ayant élaboré le Rapport et recouvrir ensemble suffisamment de secteurs d'activité différents, tout en assurant l'équilibre entre aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement. Outre l'application de ces critères, il reste inévitablement une part d'arbitraire dans le choix des questions de développement particulières ciblées par chaque Rapport.
Il s'agit de véritables "questions" qui sont encore en quête de "réponses". Bien qu'anciennes, certaines d'entre elles sont en effet particulièrement difficiles à gérer. C'est le cas, par exemple, de celles liées à la consommation de tabac ou à la mobilité des personnes. D'autres touchent à l'utilisation de nouvelles technologies. D'autres encore, comme l'économie sociale ou le financement éthique des entreprises, apportent des réponses encore incomplètes à des problèmes posés depuis longtemps. Le tableau 1.1 donne des exemples d'opportunités mais aussi de problèmes de développement concernant chacune de ces questions. Il ne traite donc pas encore des aspects spécifiquement reliés au développement durable.
1.1.2 Système sociétal, capitaux et composantes du développement
Des questions comme celles définies au point précédent concernent toutes le "système sociétal" qui rassemble tous les éléments d'une société. Elles sont pourtant souvent traitées sans être reliées entre elles, comme si elles correspondaient à des conceptions différentes du développement:
- le développement humain (centré sur la transformation de la population2);
- le développement écologique (centré sur la transformation de l'environnement);
- le développement économique (centré sur la transformation de l'économie).
Ces différents concepts de développement ont servi à formaliser différentes approches scientifiques, diverses théories et séries d'indicateurs relatifs aux états et tendances du développement. Ils sont respectivement centrés sur trois aspects différents de la richesse et du potentiel de développement d'une société. A l'instar de nombreux travaux scientifiques, ce Rapport propose de les appeler "capitaux" d'une société. Il distingue formellement les formes de capitaux suivants:
- le capital humain3: santé (y compris santé génésique), capacités et connaissances, formation, culture et expérience des populations;
- le capital environnemental: environnement (y compris diversité biologique) et réserves de ressources naturelles, distinguant les ressources épuisables des ressources renouvelables;
- le capital (technico-)économique: capital physique ou matériel (infrastructures techniques, machines et bâtiments) et financier.
Voir ce mot "capital" associé ici à des valeurs humaines4 ou naturelles peut choquer. Mais puisque ce mot signifie à la base ce qui est essentiel, fondamental, primordial, il serait encore plus surprenant de le voir réservé aux seules valeurs économiques de la société. La transformation à long terme d'une société dépend au moins autant de l'accumulation de son capital humain et environnemental que de l'accumulation de son capital économique.
L'évolution, la transformation de chacun de ces trois capitaux est donc une "composante" du développement. Certains ajoutent, à ces principales richesses de base qui sont nécessaires au développement d'un pays, une quatrième composante basée sur la notion de capital institutionnel (voir 1.1.3).
1.1.3 Réponses d'une société aux tendances du développement
Le développement d'une société peut être observé au moyen d'indicateurs sur ses capitaux humain, environnemental et économique. Il s'agit de données indiquant, par exemple, l'état des stocks et les tendances des flux de ces capitaux. Ces indicateurs permettent de décrire, d'analyser et d'évaluer les tendances d'un développement.
Lorsque ces tendances posent des problèmes ou bien lorsqu'elle aperçoit de nouvelles opportunités, la société a éventuellement la possibilité de prendre des décisions pour orienter différemment l'évolution de ses capitaux. Elle peut en effet souhaiter orienter cette évolution vers une série d'objectifs sociaux, environnementaux ou économiques qu'elle a déterminés elle-même.
Cette capacité d'orienter un développement vers des objectifs choisis a priori dépend des institutions dont dispose la population. Les réponses seront meilleures si ses institutions politiques sont de bonne qualité. La société dispose en effet d'une quatrième catégorie de capitaux: ses coutumes, ses lois, ses différentes catégories d'organismes institutionnalisés à plusieurs niveaux de pouvoir. C'est par le moyen de ce capital qu'elle peut organiser et structurer ses interventions sur les trois capitaux de base du développement:
- le capital institutionnel est l'ensemble des structures organisationnelles, légales, sociétales caractérisant la gouvernance d'un pays et déterminant les possibilités d'engagement civique, de résolution des conflits5...
Il est possible de représenter les trois capitaux définis plus haut (voir 1.1.2) comme les trois pointes d'un triangle, qui s'influencent mutuellement. Ce triangle est à la base de la figure 1.1. Lorsqu'il est tenu compte de la quatrième catégorie de capitaux, le triangle se transforme en pyramide, dont la pointe représente les institutions de la société, notamment ses institutions politiques. Cette quatrième composante est celle de la prise de décision. Il est dommage qu'elle soit souvent omise dans les analyses du développement parce qu'elle place clairement le triangle des capitaux économique, humain et environnemental dans une perspective de développement "actif" (et non passif).
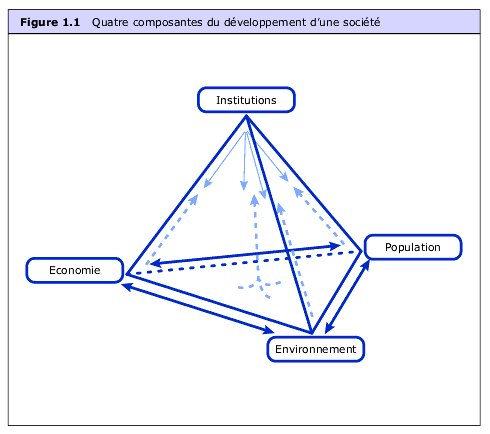
Ces "décisions" prises dans les institutions de la société peuvent être définies comme la somme des "réponses" qu'apportent les différents acteurs - politiques notamment - aux opportunités et problèmes concernant son développement. Pour répondre à certaines questions, il s'agira, par exemple, de réaliser certains types d'investissement ou de modifier certaines formes de fiscalité. La figure 1.1 montre que les informations relatives à la transformation des capitaux de la population (capital humain), de l'environnement (capital environnemental) et de l'économie (capital technico-économique) alimentent les décisions relatives aux orientations futures du développement. Ces informations montent à partir de leurs sources selon les flèches de la figure 1.1 vers les institutions où se préparent et se prennent des décisions. Des flèches redescendent alors en direction du triangle parce que les décisions prises modifient l'état de la population, de l'économie et de l'environnement ainsi que les "substitutions" entre ces trois capitaux (voir 1.2.1).
La figure 1.1 schématise donc la façon dont les quatre composantes d'une société s'influencent mutuellement au cours de son développement. Ses flèches se situent à l'intérieur de la pyramide pour insister sur le fait que les institutions ont une capacité "endogène", c'est-à-dire venant de l'intérieur du système sociétal, de modifier l`évolution de ces transformations. La société est évidemment influencée par les évolutions du reste du monde, à l'extérieur du système sociétal. Mais cela n'a pas été représenté dans la figure 1.1 pour éviter de la surcharger. Il importe de pouvoir évaluer correctement la force des influences exogènes, d'éviter de la sous-estimer ou de la surestimer. Une prise de conscience du potentiel endogène du développement est particulièrement importante pour un pays comme la Belgique. L'impression fataliste que le destin des citoyens est principalement décidé en dehors de ses frontières y prévaut trop souvent.
Un pays, fût-il petit, peut acquérir une conscience forte de son potentiel de développement endogène, de même que de l'impact effectif et potentiel de son développement national sur le reste de la planète et sur les générations futures. Cette prise de conscience, liée au débat sur la mondialisation, est particulièrement nécessaire dans les pays riches. Leurs modes de production et de consommation ont en effet des impacts plus importants que ceux des pays pauvres sur le développement du reste de la Communauté internationale. Le chapitre suivant rassemble une série d'outils existants qui permettent de formaliser cette nouvelle approche du développement.
1Task force développement durable (1999). Rapport fédéral sur le développement durable. Sur la voie d'un développement durable ? Bruxelles: Bureau fédéral du plan. p. 27.
2pnud (2001). Rapport mondial sur le développement humain 2001. Mettre les nouvelles technologies au service du développement humain. Paris, Bruxelles: De Boeck & Larcier s.a. p. 44: "La véritable richesse des Nations, ce sont leurs habitants".
3L'expression "capital social" a été évitée ici, notamment parce qu'elle se réfère, en langage courant, au capital financier des entreprises. Une notion assez floue, également appelée "capital social" ou "capital sociétal", regroupe les capitaux humain et institutionnel. Elle est donc évitée aussi pour ne pas favoriser les tendances qui confondent la composante sociale du développement avec sa composante institutionnelle.
4Un autre concept qui n'a pas été retenu ici est le "capital d'origine humaine" (man-made capital); il désigne conjointement le capital matériel et le capital humain. Il n'est pas utilisé ici pour que la notion de capital humain reste bien distincte des aspects technico-économiques.
5Bartelemus, P. (1994). Environment, Growth and Development. The concepts and strategies of sustainability. London: Routledge. p. 63.
  |
 |
|
  |
 |
Bureau fédéral du Plan - Federaal Planbureau [ http://www.plan.be ] - Please send your comments or remarks to webmaster@plan.be |