





 |
  |
|
 |
  |
|
| Printable version (PDF) | ||
2.2.6 Utilisation de plantes génétiquement modifiées: évolution en Belgique et dans le monde
L'utilisation de plantes génétiquement modifiées représente une nouvelle pression pour les capitaux humain, environnemental et économique. La superficie des cultures de plantes génétiquement modifiées est en hausse à l'échelle mondiale depuis 1996, principalement aux États-Unis, en Argentine et au Canada. En Belgique, ces cultures sont encore au stade de l'expérimentation et n'occupent qu'une superficie réduite.
Définition

La figure 2.15 présente l'évolution à l'échelle mondiale des superficies agricoles ensemencées avec des variétés génétiquement modifiées pour différentes plantes de grande culture. La figure 2.16 montre l'évolution des demandes d'expérimentations de variétés génétiquement modifiées en Belgique ainsi que le pourcentage de la superficie agricole utile que ces expérimentations représentent.
Situation et tendance
Les premières mises en culture de variétés génétiquement modifiées remontent au début des années 1990. En 1996, 2,6 millions d'hectares étaient ensemencés avec ces variétés dans le monde, principalement aux usa. La superficie totale consacrée aux plantes génétiquement modifiées (pgm) est passée à 41,5 millions d'hectares en 1999, principalement aux usa (69,1% des superficies consacrées aux pgm), en Argentine (14,0%) et au Canada (9,7%). L'Europe en comptait 10 000 hectares en 1999, soit 0,03% des superficies consacrées aux pgm dans le monde. Les taux d'adoption des pgm (passage à une nouvelle technique ou variété cultivée) tels qu'observés aux usa, au Canada et en Argentine, sont très rapides en comparaison aux taux d'adoption habituels en agriculture. Aux États-Unis, 68% des superficies de soja et 69% des superficies de coton étaient ensemencées avec des variétés de plantes génétiquement modifiées au cours de la saison 2000-2001.
En Belgique, les superficies de culture de pgm se limitent pour l'instant à l'expérimentation et sont très limitées. Les demandes d'expérimentation ont augmenté entre 1995 et 2000 pour atteindre 120 hectares, soit 0,009% de la surface agricole utile (sau). Elles diminuent depuis lors. Les demandes d'expérimentation pour 2002 concernent 34 hectares, soit 0,004% de la surface agricole utile.
Pertinence pour un développement durable
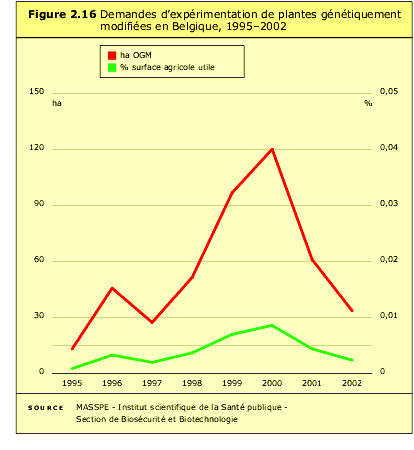
Ces indicateurs mettent en avant l'extension prise par les cultures de plantes génétiquement modifiées. Ces biotechnologies offrent de nouvelles possibilités d'utilisation et de mise en valeur des produits et services offerts par notre planète. Elles pourraient, par exemple, contribuer à la conservation de la diversité biologique (voir 2.3.3) ou contribuer à renforcer la protection de l'environnement par des pratiques agricoles non destructrices ou par la mise au point de procédés industriels plus efficaces de transformation des matières premières et de détoxication des déchets dangereux. Mais elles génèrent également de nouvelles menaces et suscitent de nouvelles interrogations quant à leur impact sur le patrimoine génétique, à leurs impacts socio-économiques et à la sécurité de leur utilisation et des produits qui en sont issus. Les risques écologiques sont entre autres dignes d'intérêt à cause du risque d'irréversibilité: si des organismes modifiés présentant des caractéristiques dangereuses ou indésirables se mettent à prospérer dans un environnement naturel ou semi-naturel, il peut devenir impossible de faire marche arrière en éliminant ces organismes.
Objectif
Le Protocole de Cartagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique1 a pour objectif, sur base du principe de précaution, d'assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne. En Belgique, le pfdd ne contient pas d'objectifs précis par rapport à l'utilisation d'organismes ou de plantes génétiquement modifiés, mais prévoit d'appliquer le principe de précaution pour encadrer le développement de ces biotechniques (voir aussi 3.2).
1Texte sur le site: http://www.biodiv.org/biosafety/protocol.asp?lg=2.
  |
 |
|
  |
 |
Bureau fédéral du Plan - Federaal Planbureau [ http://www.plan.be ] - Please send your comments or remarks to webmaster@plan.be |